Loi Duplomb : impacts écologiques, sanitaires et recours juridiques
La loi Duplomb, officiellement intitulée "Loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur", a été adoptée par l'Assemblée nationale française. Ce texte, porté par le sénateur Laurent Duplomb, vise à faciliter certaines pratiques agricoles mais est vivement critiqué pour ses impacts environnementaux et sanitaires.
)
Vous souhaitez un compte écologique ?
LA meilleure application pour gérer ses comptes - et la plus éthique ! ☀️helios a plié le game. Tout est là, et en même temps il n'y a pas de superflu.
Les points clés à retenir autour de la loi Duplomb
La loi a été écrite suite à des revendications dans les milieux agricoles pour rester compétitifs face à la concurrence d'autres pays
Elle a été vivement critiquée sur son impact écologique, notamment avec la ré-autorisation d'insecticides néonicotinoïdes (nuisant à la faune, à la flore, et avec des effets cancérigènes probables) et par l'autorisation des méga-bassines (nuisibles à la gestion de l'eau potable des habitants et à la biodiversité)
La loi a été votée par l'Assemblée Nationale en juillet 2025, mais a tout de suite fait l'objet d'une mobilisation sans précédent. Ainsi, plus de 2 millions de personnes ont signé la pétition contre la loi Duplomb sur le site de l'Assemblée Nationale
Les partis de gauche ont déposé un recours auprès du Conseil Constitutionnel qui a partiellement retoqué la loi. Ainsi le principe de précaution est retenu pour ne pas endommager notre Planète pour les générations futures, et les néonicotinoïdes ne seront pas ré-introduits en France (ils ont été interdits en 2023). Concernant les méga-bassines, des réserves sont émises en l'état : elles ne sont pas interdites mais pourrons faire l'objets de recours au cas par cas face à des juges.
Le Président Macron a annoncé qu'il signerait la loi telle que validée par le Conseil Constitutionnel, donc sans les néonicotinoïdes
Agissez aujourd'hui pour la Planète
)
Pourquoi la loi Duplomb a-t-elle été écrite ?
Elle a été conçue pour répondre à plusieurs enjeux majeurs soulevés par les syndicats agricoles, en particulier la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA). Voici une analyse plus détaillée des raisons qui ont motivé l'écriture de cette loi :
Une réduction des contraintes administratives et réglementaires
Les agriculteurs français sont souvent confrontés à un ensemble complexe de réglementations et de procédures administratives qui peuvent entraver leur activité quotidienne. Ces contraintes incluent des normes environnementales strictes, des restrictions sur l'utilisation de certains produits phytosanitaires, et des procédures longues pour l'obtention de permis de construire ou d'autorisations d'irrigation.
La FNSEA et d'autres syndicats agricoles ont plaidé pour une simplification de ces processus afin de permettre aux agriculteurs de se concentrer davantage sur leur production plutôt que sur la paperasserie.
Pour aller + loin : Quels sont les enjeux autour du Salon de l'agriculture 2024 ?
Un soutien à l'agriculture française face à la concurrence internationale
L'agriculture française est soumise à une forte pression concurrentielle, notamment de la part de pays où les coûts de production sont plus bas et les réglementations moins strictes. Pour rester compétitive, l'agriculture française doit pouvoir s'adapter rapidement aux changements du marché et aux nouvelles technologies. La loi Duplomb vise à offrir un cadre plus flexible pour permettre aux agriculteurs de mieux répondre à ces défis.
La garantie de la souveraineté alimentaire pour la France
La souveraineté alimentaire est un enjeu crucial pour la France. Elle implique la capacité du pays à produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa population sans dépendre excessivement des importations.
En soutenant les agriculteurs et en facilitant leur travail, la loi Duplomb cherche à renforcer cette souveraineté alimentaire. Cela est particulièrement important dans un contexte de changements climatiques et de tensions géopolitiques qui peuvent affecter les chaînes d'approvisionnement alimentaire.
Modernisation des pratiques agricoles
La loi Duplomb inclut également des mesures visant à moderniser les pratiques agricoles. Cela passe par l'adoption de nouvelles technologies et méthodes de production plus efficaces et durables. Par exemple, la loi facilite l'accès à des outils numériques pour la gestion des exploitations agricoles et encourage l'innovation dans le domaine de l'agroécologie.
Amélioration des conditions de vie des agriculteurs
Enfin, la loi Duplomb vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs en leur offrant un cadre juridique et économique plus favorable. Cela inclut des mesures pour améliorer leurs revenus, faciliter l'accès au crédit, et offrir des solutions pour la gestion des risques liés aux aléas climatiques et économiques.
En résumé, la loi Duplomb a été écrite pour répondre à une série de défis auxquels sont confrontés les agriculteurs français. Elle vise à simplifier les réglementations, soutenir la compétitivité de l'agriculture française, garantir la souveraineté alimentaire, moderniser les pratiques agricoles et améliorer les conditions de vie des agriculteurs.
Agissez aujourd'hui en réduisant votre empreinte carbone bancaire
)
Quelles sont les critiques sur la loi Duplomb ?
La loi Duplomb est fortement décriée pour ses implications environnementales et sanitaires. Voici une analyse approfondie des critiques formulées à son encontre :
Écologie
Utilisation de pesticides dangereux
L'un des points les plus controversés de la loi Duplomb est la facilitation de l'utilisation de pesticides dangereux, notamment les néonicotinoïdes.
Ces substances chimiques, interdites depuis 2018 en raison de leur impact dévastateur sur les pollinisateurs comme les abeilles, sont accusées de contribuer au déclin massif des populations d'insectes, essentiels à la biodiversité et à la pollinisation des cultures. En Europe, des études ont montré que l'exposition aux néonicotinoïdes peut réduire la capacité de survie des colonies d'abeilles de plus de 50 %.
Les néonicotinoïdes ne touchent pas seulement les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages et autres pollinisateurs. Une étude publiée dans la revue Nature Communications a révélé que l'abondance des espèces d'abeilles sauvages a diminué de manière significative dans les zones traitées avec des néonicotinoïdes. Par exemple, au Royaume-Uni, des recherches ont montré une diminution de 20 % de la densité des nids d'abeilles sauvages dans les zones agricoles traitées avec ces pesticides.
En plus de la mortalité directe, les néonicotinoïdes ont des effets sublétaux sur les abeilles, affectant leur capacité à se nourrir, à naviguer et à se reproduire. Ces effets peuvent affaiblir les colonies et les rendre plus vulnérables aux maladies et aux parasites.
Les écologistes craignent que cette mesure ne conduise à une détérioration accrue des écosystèmes et à une perte de biodiversité, mettant en péril l'équilibre naturel et la résilience des systèmes agricoles.
Construction de mégabassines
Les mégabassines, ou réservoirs de stockage d'eau destinés à l'irrigation, sont un autre sujet de préoccupation majeur. Ces infrastructures sont accusées de priver les milieux naturels d'eau, exacerbant les problèmes de sécheresse et de stress hydrique, particulièrement en période estivale. Les critiques soulignent que ces bassines favorisent une agriculture intensive et non durable, qui épuise les ressources en eau et dégrade les sols. De plus, elles peuvent entraîner une artificialisation des paysages et une perturbation des habitats naturels, affectant ainsi la faune et la flore locales.
Élevage industriel
La loi assouplit également les réglementations sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ce qui pourrait entraîner une augmentation des élevages intensifs. Ces élevages, souvent critiqués pour leurs pratiques environnementales et éthiques, sont associés à une série de problèmes écologiques, notamment la pollution des sols et des eaux par les déchets animaux, les émissions de gaz à effet de serre, et la déforestation pour la production de nourriture animale.
Les opposants à la loi craignent que cette mesure ne conduise à une intensification de ces impacts négatifs, au détriment de l'environnement et des communautés locales.
Santé
Exposition aux pesticides
L'exposition aux pesticides est un sujet de préoccupation majeur pour la santé publique, en particulier pour les populations vivant à proximité des zones agricoles où ces substances chimiques sont largement utilisées. Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence des liens entre l'exposition aux pesticides et diverses maladies chroniques. Voici un aperçu des principales conclusions de ces études :
Le premier risque concerne une augmentation des cas de cancers :
Leucémie et lymphomes :
Une étude publiée dans le International Journal of Cancer a montré que les enfants vivant dans des zones agricoles où les pesticides sont utilisés de manière intensive ont un risque accru de développer des leucémies et des lymphomes. Les chercheurs ont observé une augmentation de 40 % du risque de leucémie chez les enfants exposés à des niveaux élevés de pesticides.
Cancer de la prostate :
Des recherches menées par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) en France ont révélé que les agriculteurs exposés aux pesticides ont un risque accru de développer un cancer de la prostate. Une étude a montré une augmentation de 30 % du risque chez les agriculteurs exposés à des pesticides organochlorés.
Cancer du sein :
Une étude publiée dans l'Environmental Health Perspectives a trouvé un lien entre l'exposition aux pesticides et le cancer du sein. Les femmes vivant dans des zones agricoles où les pesticides sont utilisés ont un risque accru de développer cette maladie, en particulier celles exposées à des pesticides organochlorés et à des triazines.
L'autre risque concerne une augmentation des maladies neurologiques :
Maladie de Parkinson :
Plusieurs études ont établi un lien entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. Une méta-analyse publiée dans la revue Neurology a révélé que les personnes exposées aux pesticides ont un risque accru de 60 % de développer la maladie de Parkinson. Les pesticides les plus souvent associés à cette maladie sont les insecticides organochlorés et les herbicides comme le paraquat.
Troubles cognitifs :
Des recherches ont également montré que l'exposition aux pesticides peut affecter les fonctions cognitives. Une étude publiée dans la revue Environmental Health Perspectives a révélé que les enfants exposés aux pesticides in utero ou pendant leur développement précoce ont un risque accru de troubles cognitifs et de retard mental.
Les pesticides semblent également causer des troubles hormonaux
Troubles de la thyroïde :
Les pesticides peuvent interférer avec le système endocrinien et causer des troubles hormonaux. Une étude publiée dans la revue Environmental Health a montré que l'exposition aux pesticides est associée à un risque accru de troubles de la thyroïde, notamment l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie.
Diabète :
Des recherches ont également établi un lien entre l'exposition aux pesticides et le diabète. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care a révélé que les personnes exposées à des niveaux élevés de pesticides organochlorés ont un risque accru de développer un diabète de type 2.
D'autres risques pour la santé sont également pointés
Malformations congénitales :
L'exposition aux pesticides pendant la grossesse peut augmenter le risque de malformations congénitales. Une étude publiée dans la revue Environmental Health Perspectives a montré que les femmes enceintes exposées aux pesticides ont un risque accru de donner naissance à des enfants avec des malformations congénitales, notamment des défauts du tube neural et des malformations cardiaques.
Troubles respiratoires :
Les pesticides peuvent également affecter la santé respiratoire. Une étude publiée dans la revue Thorax a révélé que les agriculteurs exposés aux pesticides ont un risque accru de développer des troubles respiratoires, notamment l'asthme et la bronchite chronique.
Les études épidémiologiques montrent clairement que l'exposition aux pesticides pose des risques significatifs pour la santé publique. Les populations vivant à proximité des zones agricoles sont particulièrement vulnérables et peuvent développer diverses maladies chroniques, notamment des cancers, des maladies neurologiques et des troubles hormonaux. Ces résultats soulignent l'importance de continuer à surveiller et à réguler l'utilisation des pesticides pour protéger la santé des communautés rurales et du grand public.
Qualité de l'eau
La construction de mégabassines et l'utilisation accrue de produits chimiques agricoles soulèvent également des inquiétudes quant à la qualité de l'eau. Les pesticides et les nutriments en excès, comme les nitrates et les phosphates, peuvent contaminer les ressources en eau, affectant ainsi la santé des consommateurs. La pollution de l'eau peut entraîner des problèmes de santé tels que des maladies gastro-intestinales, des troubles neurologiques, et des cancers. De plus, elle peut avoir des impacts économiques, notamment en augmentant les coûts de traitement de l'eau pour la rendre potable.
Vous souhaitez agir pour le traitement de l'eau ?
)
La loi Duplomb est donc vivement critiquée pour ses impacts potentiels sur l'environnement et la santé publique. Les opposants à la loi soulignent que ses mesures pourraient entraîner une détérioration de la biodiversité, une pollution accrue des ressources naturelles, et des risques sanitaires pour les populations. Ces critiques reflètent les tensions entre les impératifs économiques de l'agriculture et les enjeux environnementaux et sanitaires, soulignant la nécessité de trouver un équilibre durable pour l'avenir de l'agriculture française.
Quelles actualités sur le vote de la loi Duplomb ?
La loi Duplomb a été adoptée par l'Assemblée nationale le 8 juillet 2025 avec 316 voix pour et 223 voix contre. Ce vote a marqué l'aboutissement d'un long processus législatif qui a suscité de vifs débats et controverses. Voici un aperçu des actualités récentes concernant le vote et les recours associés à cette loi :
Le texte de loi, officiellement intitulé "Loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur", a été porté par les sénateurs Laurent Duplomb (LR) et Franck Menonville (UDI). Il a été défendu par les principaux syndicats agricoles, notamment la FNSEA, qui voient dans cette loi une nécessité pour soutenir l'agriculture française face à des défis économiques et réglementaires croissants.
Réactions et controverses
L'adoption de la loi a été accueillie avec des réactions mitigées. D'un côté, les partisans de la loi, principalement des représentants du secteur agricole, ont salué une avancée majeure pour la simplification des procédures administratives et la modernisation des pratiques agricoles. De l'autre, les opposants, incluant des groupes écologistes, des associations de protection de l'environnement et certains partis politiques, ont dénoncé un "texte toxique" et un "retour en arrière brutal" en matière de protection environnementale et de santé publique.
Quelle est la décision du Conseil constitutionnel ?
Plusieurs groupes politiques et associations écologistes, dont la France Insoumise et les Écologistes, ont annoncé leur intention de déposer des recours devant le Conseil constitutionnel. Ces recours s'appuient sur plusieurs arguments principaux :
Violation des principes de précaution et de non-régression environnementale : Les opposants à la loi estiment qu'elle contrevient aux principes constitutionnels de précaution et de non-régression en matière d'environnement. Ils soulignent que la loi pourrait entraîner une augmentation de l'utilisation de pesticides dangereux et une dégradation des écosystèmes, notamment par la construction de mégabassines et l'assouplissement des réglementations sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Risques pour la santé publique : Les recours mettent également en avant les risques pour la santé publique, notamment l'exposition accrue aux pesticides pour les populations vivant à proximité des zones agricoles et la contamination des ressources en eau.
Procédure législative contestée : Certains opposants critiquent également la procédure législative utilisée pour adopter la loi. Par exemple, une manœuvre législative inédite a été utilisée pour éviter un débat approfondi à l'Assemblée nationale, ce qui a suscité des critiques sur la transparence et la démocratie du processus.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision très attendue sur la loi Duplomb le jeudi 7 août 2025. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit, l'acétamipride, un néonicotinoïde connu pour être nocif pour la biodiversité, notamment les abeilles.
La loi Duplomb crée une "présomption d'intérêt général majeur" pour les méga-bassines, ce qui signifie que les projets de méga-bassines sont considérés comme étant d'intérêt général majeur par défaut. Cela facilite leur implantation en réduisant les obstacles administratifs et juridiques. Bien que le Conseil constitutionnel n'ait pas censuré cette disposition, il a émis des réserves. Les méga-bassines pourront toujours être contestées devant un juge, ce qui n'était pas possible selon la version initiale de la loi.
La décision du Conseil constitutionnel a été saluée par les défenseurs de l'environnement et de la santé, car elle réaffirme le droit à un environnement sain et le principe de précaution, garantis constitutionnellement.
L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron promulguerait la loi dans les meilleurs délais, conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé son intention de déposer une proposition de loi pour abroger totalement la loi Duplomb.
Comment agir contre la loi Duplomb en tant que citoyen ?
En parallèle des recours juridiques, des mobilisations citoyennes et des actions de protestation continuent de se tenir à travers le pays. Des organisations non gouvernementales comme Greenpeace et des collectifs de scientifiques ont exprimé leur opposition à la loi et appelé à des actions pour la protéger l'environnement et la santé publique.
Les recours devant le Conseil constitutionnel pourraient prendre plusieurs mois avant d'aboutir à une décision. En attendant, la loi Duplomb reste un sujet de débat intense, reflétant les tensions entre les impératifs économiques de l'agriculture et les enjeux environnementaux et sanitaires. Les résultats de ces recours pourraient avoir des implications significatives pour l'avenir des politiques agricoles et environnementales en France.
Zoom sur la pétition contra la loi Duplomb sur le site de l'Assemblée Nationale
Une initiative notable est celle d'Éléonore PATTERY, qui a créé une pétition sur le site de l'Assemblée Nationale contre la loi Duplomb.
Cette pétition a déjà recueilli plus de 2 millions de votes en 3 semaines seulement, illustrant l'ampleur de la mobilisation citoyenne (https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-3014). C'est la première foi qu'une pétition reccueil plus que le seuil de 500 000 votes nécessaires pour un débat à l'Assemblée.
Face à cette mobilisation, l'actualité politique peut être chamboulée :
un débat autour de la loi Duplomb semble être d'actualités selon la présidente de l'Assemblée Nationale, mais une suspension de la loi Duplomb semble être écartée à date ;
des appels sont faits au Président Macron pour ne pas ratifier la loi Duplomb et obliger un second vote à l'Assemblée ;
le Conseil Constitutionnel pourrait être sensible à cet appel citoyen lorsqu'il devra répondre aux recours contre la loi.
 Bon à savoir : Comment fonctionnent les pétitions soumises sur le site de l'Assemblée Nationale ?
Bon à savoir : Comment fonctionnent les pétitions soumises sur le site de l'Assemblée Nationale ?
Création de la Pétition : Tout citoyen peut créer une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée Nationale. La pétition doit inclure une description claire du sujet et les demandes spécifiques adressées aux législateurs.
Publication et Signature : Une fois publiée, la pétition est ouverte à la signature par d'autres citoyens. Les pétitions sont généralement accessibles pendant une période déterminée pour recueillir un maximum de signatures.
Seuil de Signatures : Pour qu'une pétition soit examinée plus sérieusement, elle doit atteindre un certain seuil de signatures. Par exemple, une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, peut être considérée pour un débat en séance publique.
Attribution à une Commission : Après avoir recueilli un nombre significatif de signatures, la pétition est attribuée à une commission parlementaire pertinente. Les députés de cette commission désignent un député-rapporteur qui sera chargé d'examiner la pétition.
Examen et Rapport : Le député-rapporteur propose soit d'examiner le texte de la pétition au cours d'un débat faisant l'objet d'un rapport parlementaire, soit de classer la pétition si elle ne répond pas à certains critères ou n'est pas jugée prioritaire.
Débat en Séance Publique : Si la pétition est jugée recevable et importante, la Conférence des présidents de l'Assemblée Nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique. Cela permet aux députés de discuter des demandes et des préoccupations soulevées par la pétition.
Suivi et Réponse : Les pétitions qui aboutissent à un débat en séance publique peuvent conduire à des actions législatives ou à des réponses officielles des autorités concernées. Les citoyens sont informés des suites données à leur pétition.
Ce processus permet aux citoyens de participer activement à la vie démocratique et d'influencer les décisions politiques.
Faites un geste qui compte vraiment pour la Planète
)
La loi Duplomb est un texte clé pour comprendre les tensions actuelles entre soutien à l'agriculture et protection de l'environnement et de la santé publique en France. Alors que ses partisans voient une nécessité économique, ses détracteurs y voient une régression environnementale et sanitaire. Les recours juridiques en cours pourraient redéfinir l'équilibre entre ces enjeux cruciaux.
Sources
Reporterre : Loi Duplomb : adoption d'un texte funeste pour l'environnement
Franceinfo : Loi Duplomb : découvrez si votre député a voté pour ou contre ce texte controversé sur l'agriculture
Natura Sciences : Loi Duplomb : mobilisation pour "remettre la science au coeur du débat"
Pour aller + loin :
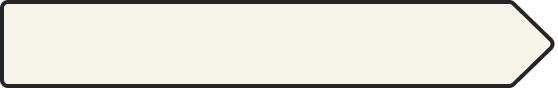
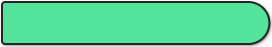





)